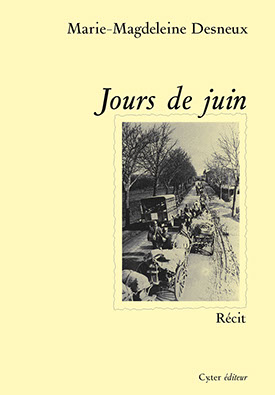La guerre vient sur nous ! Cette pensée s'impose brutalement à moi. Du balcon de la bibliothèque d’où j’ai joui tant de fois de la douceur voluptueuse de la Loire, je contemple le pont, couvert de camions militaires qui passent, qui passent, sans trêve, sans ralentir, comme s’ils étaient poursuivis. Depuis des jours et des jours la file des autos n’a pas cessé de traverser la ville ; mais l’impression, poignante pourtant, que je ressentais devant l’interminable fuite des civils n’était rien en comparaison du choc que je reçois ce matin : la guerre vient sur nous ! Et ces camions ne s’engagent pas dans la rue Nationale : ils obliquent à gauche — consigne sans doute : il faut dissimuler la retraite, éviter de révéler la vérité à la population — comme si l’espoir était encore possible ! Tout à l’heure, un étudiant de l’institut plaisantait :
« Vous avez vu le « 75 » ?
— Mais oui !
— Et c’est avec ça qu’on va faire la résistance sur la Loire ! »
Il s’esclaffe. Piètre défense en vérité que celle qui se prépare : il est là, le « 75 », ridiculement braqué vers le pont, jouet dérisoire : un canon pour défendre Tours ! Un canon pour interdire l’accès d’un des plus importants passages de la Loire !
« Il va tout juste servir à nous faire bombarder ! »
C’est bien possible — mais nous en rions — en gens qui en ont entendu d’autres : les Tourangeaux ont si bien l’habitude d'entendre la D.C.A., depuis dix jours surtout, qu’ils se croient aguerris.
Je redescends la rue Nationale : fourmilière dans laquelle on aurait donné un coup de pied. Les trams ne circulent plus : je reviens, sans cesse heurtée dans cette foule fiévreuse.
Sous les arbres de l’avenue — pourquoi est-ce la guerre ? il fait si beau, il pourrait faire si bon dans la splendeur de ce mois de juin — je rencontre une de mes élèves de seconde :
« Ah ! Mademoiselle, je suis heureuse de pouvoir vous dire au revoir.
— Comment ? vous ne revenez pas ce soir ?
— Mais Mademoiselle, le lycée est fermé !
(Tours, vendredi 14 juin 1940, p.13-14.)
Je suis sauvée. Cette fois, à ma troisième étape, j'ai la certitude de gagner Blois rapidement.
L’aspect d'Amboise est inimaginable. La petite ville est encombrée de voitures de toutes sortes qui stationnent sous les arbres des quais : autos, charrettes, longues files de voitures à gerbes dont la forme annonce des régions éloignées de la nôtre. Bestiaux, chevaux, sont groupés en désordre. Et toujours, de plus en plus semble-t-il, ce flot descendant de voitures, de camions militaires, de tanks qui ferraillent. Notre voiture stoppe. Les jeunes gens descendent. Des gendarmes détournent les voitures et nous ne franchissons le barrage qui coupe la route montant vers Blois que parce que le conducteur présente des papiers militaires.
Seuls dans la voiture, nous échangeons nos impressions : l’affaire est réglée, c’est la déroute. Mon guide ne croit pas à la défense de la Loire.
« Mais avec quoi ? me dit-il. Où voyez-vous une armée ? Mais on ne peut pas reformer un front, c’est la déroute complète. Et de l’artillerie ? »
Le fait est qu’entre Montlouis et Blois nous n’allions rencontrer qu’un soldat, baïonnette au canon, montant la garde devant le pont d’Amboise, et une mitrailleuse devant le pont de Chaumont.
En cours de route, mon soldat rendra service à quatre réfugiés qu’il prend à bord. Nous continuons à nous entretenir, en parfait accord dans nos jugements, sur le gouvernement, sur la stupidité des circonstances de la déclaration de guerre, sur l’état actuel de l’armée, sur l’inutilité d’une défense quelconque. Le spectacle est étrange : la Loire coule, lente, dans la splendeur de cette journée de juin. Parfois nous croisons des bataillons de réfugiés à bicyclette, et l’on se croirait sur une route de tourisme aux jours de camping, tant la voluptueuse vallée semble inviter à la joie. Puis, ferraillant, se dépassant, fuyant à qui mieux mieux, des chenillettes, des tanks, des camions, toujours, encore ! Voici un embouteillage. Mon conducteur s’arrête.
« Ah ! ces aviateurs, partout où ils sont, c'est pour mettre le désordre. »
Ce sont en effet des camions bourrés de jeunes aviateurs, sans doute ceux qui, je le saurai plus tard, lançaient à la volée, dans leur traversée de Blois, boites de pâté, sardines, canards vivants !
Mais vont-ils dégager ? Le soldat s’impatiente, descend, parlemente. Lentement, comme de mauvaise grâce, un aviateur va se poster vers la queue du convoi. Quelques voitures se déplacent. Nous pouvons passer. Là, je remarque alors cette remarquable trouvaille stratégique : deux tombereaux renversés barrent la route, obligeant à décrire de ces savantes courbes en épingles à cheveux comme dans les virages de montagne. Il paraît que c’est ce qu’on a trouvé de mieux pour barrer la route aux envahisseurs ! Enfantillage ? Ignorance ? Démence ? Je songe aux chaînes que j'avais vu tendre dans les rues de Marchenoir au cours de l’autre guerre pour « barrer la route aux espions ! » Le peuple est-t-il donc si puéril qu'il faille agir ainsi sur les imaginations ?
Nous devions rencontrer quatre ou cinq, au moins, de ces efficaces barrages, entre Amboise et Blois. [...]
Un gendarme s’est approché de la voiture arrêtée. J’en profite pour lui demander si mon père est encore dans la ville. Il ne sait rien, mais il croit l’avoir vu le matin. Je suis rassurée. Mes bagages à la main, je m’engage sur le pont où se pressent dans une affolante confusion des camions militaires. Le pont franchi, une anxiété m’envahit. Je n’ai jamais rien vu de si poignant que ce spectacle de toute une population figée, comme pétrifiée en plein exode. Serrées à se toucher les unes les autres, des voitures de réfugiés attendent de pouvoir s’engager sur le
pont où seules passent les voitures militaires. Derrière toutes ces glaces, les mêmes visages creusés par la fatigue et l’angoisse. Par centaines, comme des chenilles, en file interminable et immobile, les autos couvrent les rues mornes de la ville. Les magasins sont fermés. Je les longe à contre-courant, songeant que mes parents sont peut-être dans une de ces voitures. Me verront-ils ? Je prends la rue Porte-Chartraine, je monte le Bourg-Neuf. J’approche du 47. Ah ! les contrevents sont entrebaillés. Je m'approche, et presque gaiement :
« Y a-t-il une petite place pour une réfugiée ? »
Et la voix chevrotante de grand-mère me répond :
« Mais non, Madame, nous allons partir ! »
Je sonne. Je n’entends que la voix de papa :
« Ah ! c’est Mamène ! »
Puis un cri, une course, et maman s’abat sur moi, m’embrasse, me serre :
« Ah ! Ma petite fille ! Ma petite fille ! »
Je suis là, debout sur le seuil, mes paquets à la main, immobilisée par maman qui répète : « Ma petite-fille ! »
(Samedi 15 juin, p.40 à 42.)