
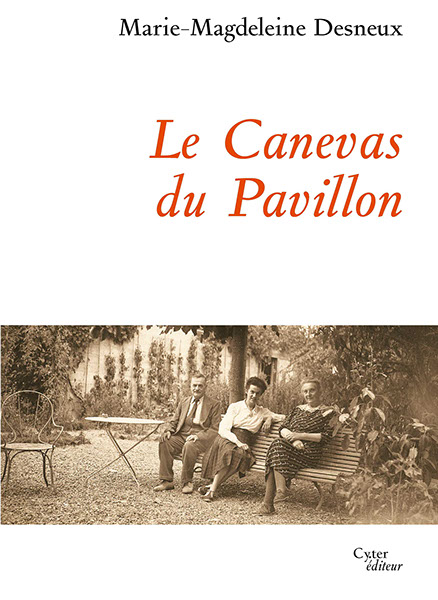
Tu réfléchissais donc. Et je crois bien que ce n’est pas par hasard si tu as eu, quelques jours plus tard, l’obligation de te rendre chez M. Blanchier. Il fallait d’urgence lui remettre un acte, ton mari te chargea de ce soin alors qu’il partait « en tournée ».
M. Blanchier te reçut. Il était à tes yeux un personnage grave, imposant, important. Un peu après tu allais connaître plus familièrement sa femme, une anglaise, charmante et accueillante. Mais cette première visite était assez solennelle. Qui le premier engagea la conversation sur les projets d’études — qui n’avaient encore été que des exhortations ? Il me plairait que ce fut toi. Je suis sûre que ce fut toi.
« À Poitiers ? Mais non, Madame, il ne serait pas obligé d’aller souvent à Poitiers. Pour ses inscriptions, oui, et pour faire la connaissance de certains professeurs. Mais pour ce diplôme, le travail sur de bons livres suffit. Mon père les lui procurera, ces livres. Et moi je le guiderai pour le programme, je suis à sa disposition pour tous les conseils dont il aura besoin. [...] Dans deux ans, ce sera fait, il aura sa capacité en Droit et il pourra aussitôt être nommé juge de paix, il sera mon collègue. Voyez-vous, ce qu’il fait ne lui convient pas. Il le fait très bien, il est courageux puisqu’il ajoute à cela une activité qui se rapporte à la banque. Mais il faut qu’il sorte de là, il mérite mieux que cela, vous êtes jeunes tous les deux, il est intelligent, il doit se faire une carrière. [...]
— Mener deux choses à la fois ? Mais il le peut, Madame, je ne lui donnerais pas ces conseils si je n’avais jugé sa valeur. Voulez-vous que je vous dise ? S’il ne le fait pas, ce n’est qu’un flemmard ! »
Le mot t’avait cinglée. Et il était dit avec un tel accent de conviction que ta résolution fut prise sur-le-champ.
Tu rentras à la maison — cette maison que je viens de revoir, dans l’angle de la place,
avec ses deux jeunes époux, tristes à l’âge où l’on est fou de joie, tristes du deuil récent, tristes de la douleur des parents, hésitants au seuil de l’avenir alors qu’un nuage si lourd venait d’obscurcir le passé... Tu rentres à la maison. Je te vois avec ton pas énergique, ta haute silhouette mince et souple, ta beauté rayonnante d’énergie. Ton mari n’était pas rentré. Quand il arriva, le déjeuner était prêt. Et c’est autour de la table que la décisive conversation s’engagea.
« Tu sais, j’ai vu M. Blanchier.
— Tu lui as remis l’acte ? Il était satisfait que j’aie pu l’établir si vite ?
— Ça, je n’en sais rien. Ce qu’il m’a dit, c’est qu’il faut que tu prépares la capacité en droit.
— Encore ! J’en ai assez de ces rabâchages.
— Écoute, il faut que tu ailles à Poitiers le mois prochain.
— Toi aussi ? Mais tu plaisantes ?
— Non, moi je suis décidée. Parce que M. Blanchier a dit que si tu ne le fais pas, c’est que tu n’es qu’un flemmard !
Le mot t’avait cinglée. Mais il fit bondir ton mari.
— Un flemmard, moi ! Après ce que je fais depuis que je suis ici ? Le travail de la justice de paix, et les tournées, et la banque ? Un flemmard, moi ? Il a de l’audace celui-là ! Il a osé dire que j’étais un flemmard ?
— Il n’a pas dit cela, il a dit que si tu ne préparais pas tes examens tu n’étais qu’un flemmard. Mais tu vas les préparer. [...]
Avec ta souple ténacité, tu avais en huit jours transformé les châteaux en Espagne en ambition nécessaire, l’épouvantail de la Faculté en attrait de la découverte, la crainte de l’échec en élan vers la bataille — une belle bataille de la vie, que vous alliez mener à deux...
Car ton mari alla prendre ses inscriptions à la faculté. Il revint chargé de bouquins. Et chaque soir, les papiers en règle — la lourde presse à polycopies de ce temps-là donnait parfois des copies illisibles qui obligeaient à tout recommencer — la bicyclette nettoyée et graissée pour la « tournée » du lendemain, la sacoche vidée et la caisse vérifiée, vous vous mettiez tous deux à l’œuvre. [...]
Vous aviez le cœur droit, et dans les ténèbres du deuil une lumière s’était levée. Vous attendiez, le cœur plein d’espérance, votre premier enfant.
Ton mari — je puis maintenant dire mon père — réussit son premier examen. Des blanches, une seule noire (c’étaient les notes) émanant d’un professeur loup-garou, redouté de tous, ennemi de ton protecteur. Mais c’était un beau succès. Tu reçus une surprise. Tu avais, en feuilletant une revue, dit un jour : voilà un petit meuble qui doit être bien pratique. C’était un « bonheur du jour » à la mode de la Belle Époque. Des casiers, une petite vitrine, une table à secret, des tiroirs aux multiples combinaisons. De quoi combler une jeune femme d’alors en lui permettant de mettre en sûreté ses livres, ses menus ouvrages, ses secrets. Et un beau jour, Jarrain, le conducteur de la diligence, arrêta ses chevaux dans un joyeux bruit de grelots et de roues ferrées.
« Un colis pour vous, et bien encombrant ! »
Et encore un autre, et bien lourd !
C’était le « petit meuble » — il est toujours dans ta chambre — et, par-dessus le marché (les fournisseurs étaient généreux en ce temps-là) une collection de Lisez-moi, revue où paraissaient les œuvres de Loti, France, Maupassant, Richepin, Theuriet, Gérard d’Houville. Les auteurs à la mode. La collection est toujours là, sous les couvertures rouges usées d’avoir été souvent entre les mains.
Tu grondas un peu, beaucoup, ton mari. Mais il riait de ta fâcherie. Il te sentait si heureuse de posséder un meuble, tu mis tant d’empressement à en garnir les rayons et les tiroirs secrets... Secrets pour vous deux, naturellement. Car tu ne cachas jamais rien, que les peines au fond de ton cœur, quand il fallait les cacher pour éviter de faire souffrir les autres.
(5 septembre 1965, p. 42-44.)
C’était en 1934-1935. Dans le courant des six ou sept mois où mon père résida à Nevers.
Était-ce en cette période de l’année ? Je le croirais, en raison de l’insistance avec laquelle cette même aventure s’est imposée à moi au cours de ces vacances.
Nous habitions, grand-mère et moi, dans ce meublé que tu nous avais trouvé à Tours, rue Émile-Zola — quartier « résidentiel » ! — à deux pas de l’Évêché, dans la maison de Mme de la Raudière. Notre appartement donnait sur le jardin de l’Évêché que traversaient toute la journée des ecclésiastiques. Fond de décor : la cathédrale, la Psallette, le cèdre de l’ancien Évêché. Le vieux Tours aristocratique. De notre second, nous dominions ce noble paysage urbain.
Tu étais arrivée (de la veille, peut-être). La nuit était paisible. Nous dormions, grand-mère dans sa chambre, toi et moi dans deux chambres contiguës dont la porte de communication était restée ouverte. Un bruit de voix dans la rue me réveille à demi :
« Oh... oh... ai... oh... oh... ai. »
Je ne reprends pas nettement conscience. C’était à une époque où la circulation nocturne était à peu près inexistante dans ce quartier.
Silence. Je me rendors.
Cela reprend comme un leitmotiv : « Oh... oh... ai... oh... oh... ai. » Ce n’est ni un chant, ni une plainte. Un appel, peut-être ? Alors, tu m’interpelles :
« Tu entends ? il en fait du bruit, celui-là : oh... oh... arrive. oh... oh... arrive.
— Oh... oh... qu’arrive. Oh... oh... c’est moi qui arrive.
Les mots se font distincts, maintenant que je suis éveillée. Cela monte de la rue, juste au coin.
— Tiens, me dis-tu, c’est quelqu’un qui veut rentrer chez lui, et on ne l’entend pas. Il a dû oublier sa clef.
— Oh... oh... c’est moi qui arrive !
— Ah, ils ont l’oreille dure dans cette maison-là. Est-ce qu’ils vont finir par l’entendre ? Si c’était moi, il y a longtemps que j’aurais été ouvrir.
L’appel retentit de nouveau, après une longue pause.
— Oh... Oh... c’est moi qui arrive.
Cela devient obsédant.
— Ah ! C’est curieux, me dis-tu. Elle s’appelle comme moi.
— Mais tu rêves, cette fois, Maman ?
— Non, écoute : il dit : Laure !
— C’est une idée ! Tu rêves, c’est sûr.
— Non, cette fois, j’ai entendu : Laure ! Laure ! C’est moi qui arrive.
Et soudain tu sautes du lit :
— Mais c’est ton père !
— Comment ? À cette heure ?
Tu ouvres la fenêtre :
— C’est toi ?
— Ah ! Je croyais que tu n’entendrais jamais. »
Tu descendis car c’était la maison du mystère, impossible de se faire ouvrir par la domestique, invraisemblable créature. D’ailleurs mon père n’avait pas voulu sonner, sachant que la sonnette n’était entendue que dans l’appartement de la vieille propriétaire. Ah ! comme je vous revois ! Les explications, les échanges de paroles heureuses, rapides. Mais comment ? Tu ne devais venir que dans deux jours ? Oui, mais le procureur... alors mon greffier...
Comme un potache trop heureux d’échapper à l’internat, mon père avait saisi l’occasion inespérée, avait pris le premier train, sans souci de l’heure d’arrivée un peu indue, ni des complications de l’accès nocturne dans la maison trop bien fermée ! Il se réjouissait de sa persévérance. Il avait été sur le point, nous dit-il, de retourner à la gare pour achever la nuit dans la salle d’attente.
Il me semble encore sentir ses mains et ses joues froides de l’air vif de la nuit, entendre sa chaude voix sonore : « Pas si fort, tu vas réveiller Mme de La Raudière.
— Sûrement pas, j’avais beau crier, personne n’a remué dans la maison. »
Ah ! la joie d’être réunis, les bavardages, quand même assourdis, l’infusion ou le grog, pour réchauffer.
Voyons, voyons, il est temps de se coucher ! On ne croirait pas que tu as passé une partie de la nuit dans le train — et dans la rue !
Comme il fait bon — comme il fait bon de s’aimer. Est-il possible que ce soit si loin ? Que ce soit à jamais fini ? Que je sois seule à entendre l’appel qui monte du bas de la rue —du fond de la nuit, du fond de l’abîme.
« Laure ! Laure ! C’est moi qui arrive ! »
De profundis clamavi ad te...
(3 janvier 1967, p.223-225.)
[...]
Comment ne pas me reconnaître devant ces refus ? Ou devant ce que les autres prennent pour des refus, et qui n'est qu'un échelonnement des valeurs, une soumission douloureuse à des exigences plus hautes ?
Cette jouissance, oui, ce bonheur, oui. Mais pas avant que le devoir ait été accompli. Sinon, « comment me présenter devant celui ou celle qui représente le bonheur ? Je ne serais pas digne ».
Il faut d'abord que j'aie réalisé ce « moi » d'honneur et de perfection, que j'aie accompli la tâche que j'ai reconnue comme acte essentiel, réclamant toute mon énergie ; et le bonheur, après seulement, sera le fruit de mon courage. J'aurai atteint la réalisation de mon être qui me rendra digne...
Ce n'est pas toujours aussi net. Mais cela s'exprime de la même façon (je ne pourrais pas me présenter devant elle), « autrement je ne peux plus me présenter là-bas... et il se tourna vers la maison des Sablonnières. »
« À moins que d'opposer à tes plus forts appas
Qu'un homme sans honneur ne te méritait pas...
[...] Qu'écouter ton amour, obéir à ta voix,
C'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix.
[...] Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter
Pour effacer ma honte et pour te mériter. »
Et la foule des médiocres ricane de ce Devoir « avec un grand D » qui écarte les bonheurs faciles.
Quelques-uns, assez réfléchis pour ne pas en rire, n'y voient qu'un orgueil inflexible.
Seuls ceux qui se sont engagés dans la recherche d'un accomplissement de soi préalable à toute acceptation d'un bonheur qui semblait à portée de la main peuvent comprendre les inexplicables refus d'être tout à coup et tout de suite heureux.
Mais oui... les âmes cornéliennes. Qui ne sait pas que Meaulnes est le Cid du début de notre siècle, le gentilhomme d'une autre classe sociale, le disciple de ces instituteurs du début de la IIIe République qui, relevant le flambeau tombé des mains d'une aristocratie démantelée, enseignaient cette morale orgueilleusement exigeante qui allait bientôt conduire les jeunes hommes de France sur les cimes de l'héroïsme de 1914. Comme il est significatif que le créateur de ce Meaulnes tourmenté d'idéal ait connu ce destin, la fulgurante agonie de celui qui s'écroule face à l'ennemi.
Et moi aussi, qui ai reçu par ma mère, fille d'instituteur, cette exigeante passion de noblesse d'âme, moi qui ai vu vivre des parents inflexibles sur les devoirs qu'imposent les circonstances, moi aussi j'ai fait passer les orgueilleuses valeurs avant l'attrait de la nature. Je n'ai pas dit non. J'ai dit « d'abord cela ». [...]
« Dans la mort seulement, dit Meaulnes, je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là. »
(12 octobre 1967, après la cinquième séance du Grand Meaulnes, p.278-281.)
Quatre feuillets, couverts d’une écriture élégante et ferme... quatre feuillets jaunis, une encre pâlie... et la vie, toute votre vie qui frémit en mon cœur...
Une autre lettre :
« Mes chers enfants, ma chère petite Laure,
Voilà huit jours que tu es partie. Il me semble qu’il y a un siècle... »
C’est ta mère... Qu’ils sont longs, les jours sans toi... C’est toujours cette même terrible privation pour ceux qui ont été irradiés de ta lumière. Il faut t’avoir connue pour savoir combien de regards se sont levés vers toi, combien de mains se sont tendues vers toi.
Je vois, au long de ma vie, ces visages de vieilles femmes, de malades anxieux, et qui se détendaient, et qui s’adoucissaient, et qui souriaient lorsque tu t’approchais. Ces visages d’enfants, d’amis, qui s’épanouissaient en ta présence. Je ne connais plus rien de semblable. Et à la réflexion, il me semble que je n’ai jamais rien connu de semblable ailleurs.
J’entends cette parole : « Il n’y en avait qu’une, et c’est vous qui l’avez. » Jamais, jamais je ne dirai assez la noblesse qui était en toi.
« Que fais-tu ? » demande ta mère.
Et elle te présente les occupations familiales : « Il est 5 heures. Je fais mon dîner, Aristide est en lecture, ton papa dans la classe à écrire... » Suivent quelques lignes sur une visite. Et la question est reprise :
« Et toi ma petite mignonne, que fais-tu ? »
Ce besoin de savoir ce que fait l’être aimé... Notre époque semble ne plus connaître cette préoccupation. En rejetant toutes les contraintes, toutes les inquiétudes, toutes les sollicitudes, a-t-on trouvé le bonheur ? Romans et films modernes donnent à croire qu’il n’y a pas d’autre valeur que « l’amour libre ». Heureux ceux qui ont connu la tendresse des liens familiaux. L’ironie des cyniques n’est qu’une atroce négation, peut-être une aride ignorance.
« Et toi, que fais-tu ? Es-tu toujours heureuse dans ton petit paradis, comme tu le dis ? »
Et la demande se fait insistante, suppliante : « Qu’elle soit longue, très longue, ta lettre. »
Suit un mot « personnel » :
« Mon cher Gaston, êtes-vous toujours content de votre petite femme, est-elle bonne cuisinière, cordon-bleu ? Il faut faire comme aux petits enfants, lui dire que c’est bon, tant pis si c’est mauvais, il faut l’encourager » ... « Vous me dites sur votre lettre que c’est le bonheur pour vous deux. »
(20 avril 1969, p.356-357.)
Et une fois encore il y eut un hiver, il y eut un printemps...
Les parents reprirent la route du Berry, passèrent près de vous les mois sombres, dans l’activité grandissante de l’étude. Toujours les départs à bicyclette, à l’aube, les tournées en voiture, le courrier abondant, les récits des « audiences », les promenades au château de la Lande, quelques parties de pêche sur l’étang de Bornacq, les écritures, le soir, la préparation fébrile des envois chargés avant la fermeture de la poste, les rouleaux d’or comptés dans le coffre-fort, les copies sous la « presse », le défilé pittoresque des clients les jours de foire. Et mars arriva, la saison du bêchage. Là-bas le Pavillon, le grand jardin appellent... Les parents refont les malles, reprennent la patache pour la gare d’Urçay où un gendre les accompagne. Tu n’as plus tes longs voiles de crêpe, ma grand-mère. Mais des vêtements noirs. Tu ne quitteras jamais le deuil.
Voilà donc les « enfants » de nouveau seuls à Saulzais pour la belle saison 1907.
Comme l’an dernier, la voiture anglaise file bon train sur la route poudreuse, les sabots claquent, les grelots tintent. Vous vous êtes fait des amis depuis ces deux années. Les « demoiselles de la poste » sont de la promenade. Selon la disposition des « banquettes » dans ce genre de voitures basses, elles sont assises en tournant le dos au sens de la marche. C’est toujours toi, Maman, qui tiens les guides. Tu bavardes gaiement avec mon père, les demoiselles en font autant entre elles... 1
Soudain un choc... deux cris... un autre choc qui déplace l’équilibre de la voiture et nous porte en avant, la jument sent la charge sur sa croupe et s’emballe... Course folle avec des soubresauts. Sans perdre ton sang-froid, tu tires sur les rênes, tu maintiens la jument affolée, tu réussis peu à peu à réduire son allure... Enfin, elle s’arrête, haletante, sa robe toute mouillée de sueur, la voiture toute penchée vers la droite. Ton mari, blême, te pose mille questions : « Laure, ma petite Laure, as-tu mal, dis, as-tu mal ? Oh ! ma chérie, je t’en prie, dis-moi que faire, as-tu mal ?
Et toi, nullement émue, tu ris, tu rassures :
— Mais non, je n’ai rien, tu vois bien, je n’ai aucun mal, ne t’effraie pas comme cela.
— C’est bien vrai ? Tu n’as pas de mal ? Oh ! j’ai eu si peur pour toi, pour... notre enfant !
Les jeunes époux descendent, lui tenant fortement la jument près du mors. Là-bas, tout là-bas sur la route encore embrumée de la poussière soulevée par la voiture folle, les deux demoiselles.
Que s’était-il donc passé ?
Placées comme elles l’étaient, elles avaient vu une roue de la voiture rouler devant elles ! L’ouvrier qui avait procédé la veille au graissage avait mal replacé le joint de sûreté qui assurait la fixation, et une roue s’était détachée (la voiture ne tombait pas pour autant puisque les deux brancards étaient pris dans le harnais du cheval). Mais effrayées les deux passagères avaient sauté sur la route (voiture basse, trot de la jument pas très rapide, cela pouvait se faire sans danger). Ce fut la cause du second choc : allégé de sa charge à l’arrière, la voiture avait basculé vers l’avant, d’où la poussée sur la croupe et l’affolement de la bête ombrageuse.
On gagna à pied le village voisin, le charron répara le dommage, chacun admira le sang-froid de la conductrice, très fière de son exploit (les chevaux emballés étaient alors cause d’accidents) et comme il fallait bien expliquer pourquoi le jeune époux était bien plus bouleversé que sa femme, on sut depuis lors que « chez l’huissier de Saulzais on attendait un bébé ».
Après avoir été la maison de la mort, la maison de Saulzais abritait maintenant l’espoir de la vie.
(6 juin 1974, p.425-426.)